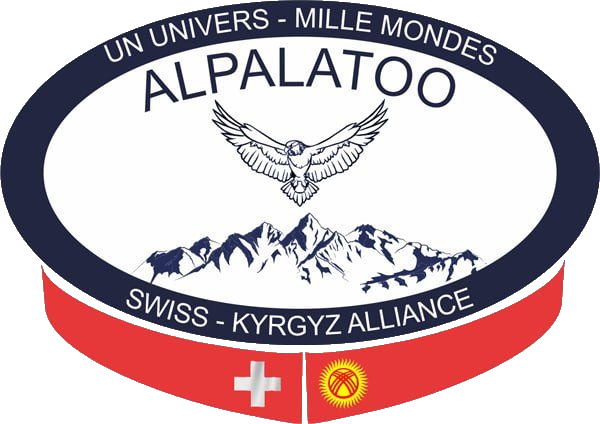-Votre École du Monde a été créée quelle année ?
-Le 8 janvier 2001, c’était le premier jour de cours ici. Donc, cela fait déjà 24 ans. À l’époque, je travaillais déjà comme professeur de français dans une autre école étrangère. Un jour, ma femme m’a dit : « Mais tu ne vas pas rester toute ta vie un petit prof de français. Crée une école. Tu as étudié l’économie à l’université, tu sais gérer, tu peux faire la comptabilité, et ainsi tu feras quelque chose pour toi. » J’ai trouvé cela comme une bonne idée. Alors, je me suis lancé dans les démarches administratives, ce qui, en Suisse, n’est jamais simple. On ne peut pas ouvrir une école comme on ouvre un kiosque ou même un garage. Il a donc fallu beaucoup de travail et c’était long à préparer. Par exemple, j’ai dû signer le bail de cet endroit avant même d’avoir l’autorisation d’ouvrir l’école. Il fallait préparer un business plan, présenter les professeurs et, si ces derniers n’étaient pas Suisses, s’assurer qu’ils aient un diplôme de professeur. Depuis l’ouverture de l’école, j’ai accueilli des étudiants de 123 nationalités différentes, y compris des Suisses. J’ai même eu deux étudiants venus de Corée du Nord.
-Avez-vous remarqué si certaines nationalités sont plus débrouillardes pour apprendre une nouvelle langue ?
Eh bien, cela dépend des personnes, c’est vraiment très varié. Mais il est évident que j’ai observé quelques tendances. Par exemple, les Sud-Américains, comme les Brésiliens, les Colombiens ou les Péruviens, parlent sans hésiter, même s’ils font beaucoup de fautes. Ils ne sont pas bloqués par la peur de faire des erreurs, ce qui leur permet de progresser rapidement, même si les règles de grammaire les intéressent un peu moins.
En revanche, les étudiants asiatiques, comme les Japonais ou les Chinois, ont une approche très différente. Ils se concentrent principalement sur la grammaire, et donc, ils réussissent à appliquer les règles de manière impeccable. Cependant, pour eux, l'oral est beaucoup plus difficile, car ils ne veulent pas parler tant qu'ils ne sont pas sûrs que la phrase qu'ils vont dire est parfaitement correcte. Ils attendent donc trop longtemps, et parfois, quand ils finissent par parler, la conversation a déjà changé de sujet.
Latinos ou Asiatiques : deux approches d’apprentissage opposées
Analyse des méthodes distinctes d'apprentissage des langues entre étudiants extravertis et perfectionnistes, et leurs impacts sur la progression.
Ce qui ressort de cette comparaison, c'est que les étudiants plus extravertis, surtout en provenance d'Amérique du Sud, prennent plus de risques en parlant, tandis que les étudiants asiatiques, plus réservés, sont davantage focalisés sur la perfection grammaticale. Du coup, quand on fait des tests écrits, les étudiants asiatiques réussissent souvent très bien, mais pour l’oral, c’est une autre histoire. Et pour les Latinos, c’est l’inverse : ils sont plus à l’aise à l’oral.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, j’ai proposé un tarif spécial pour les Ukrainiens, et j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes venant de ce pays. Écouter leur histoire permet de relativiser nos petits problèmes quotidiens, surtout quand on entend des gens qui ont vécu dans un contexte de guerre. Cela m’a également rappelé que, dans les classes, nous avons parfois eu des étudiants de nationalités en conflit, ou qui le sont encore. J’ai eu des étudiants russes et ukrainiens dans la même classe, et ça se passe très bien. À une époque, j’avais aussi des étudiants serbes et du Kosovo, et cela se passait aussi très bien. Ils étaient là pour apprendre le français, avec un objectif commun, et ils laissaient leurs conflits de côté pour se concentrer sur leurs études.
J’ai eu la chance de suivre certains de mes étudiants qui ont poursuivi des études universitaires brillantes. Il y en a une, une étudiante russe arrivée il y a quelques années, qui a terminé ses études en psychologie, parle parfaitement français et a trouvé du travail ici. Deux étudiants se sont même mariés, et j’ai été invité à leur mariage. J’ai aussi gardé contact avec certains étudiants, devenus des amis. J’ai eu à peu près 3500 étudiants au total, et parmi eux, il y en a certains avec qui j’ai conservé une relation particulière.
-À Genève, il y a beaucoup d'écoles privées, mais avez-vous une méthode spéciale ?
-Ce qui est unique ici, c'est que nous avons une petite structure. Ce n’est pas une grosse institution avec un système impersonnel où les étudiants restent anonymes. Ici, tout le monde se connaît. Nous avons un système où les professeurs changent de classe tous les trois mois, ce qui permet aux professeurs de connaître chaque étudiant. Tout le monde se familiarise, et cela crée une atmosphère conviviale. De plus, nous organisons de nombreuses activités. Par exemple, la semaine prochaine, nous aurons une soirée théâtre. Chaque année, nous organisons au moins un événement théâtral. Nous planifions aussi diverses fêtes, comme celle de Noël, ainsi que des pique-niques d’été. Nous organisons beaucoup d’activités extérieures, comme des randonnées avec les étudiants, afin de renforcer le lien et favoriser l’intégration.
-Et maintenant que nous sommes au XXIe siècle, la langue française a-t-elle beaucoup changé par rapport à avant ? S’est-elle enrichie au fil des siècles ou, au contraire, appauvrie ?
-Oui, à mon avis, ce n'est pas vraiment un enrichissement, c'est plutôt l’inverse. Aujourd’hui, je remarque un phénomène inquiétant, notamment lorsque je demande des devoirs de production écrite : certains étudiants utilisent ChatGPT. Ce n'est pas acceptable. Et une autre difficulté, ce sont les téléphones. Parfois, je donne une explication à un étudiant, et il me dit : « Non, mais mon téléphone a dit ça. » Je lui réponds : « Vous me croyez, moi, qui enseigne le français depuis 30 ans, ou votre traducteur Google ? » Et c’est pour cela que nous avons instauré un jour sans téléphone le vendredi. Parce que je vois que certains étudiants, dès qu’ils entendent quelque chose, ils vérifient sur leur téléphone s’il est correct. Cela devient un poison pour l'apprentissage.
Je pense qu'à l'époque, les gens parlaient d'une manière beaucoup plus soutenue qu'aujourd'hui. Prenez par exemple les grands classiques de la littérature : ils utilisent des formes du subjonctif imparfait, ce que plus personne n'emploie de nos jours. Même dans les dialogues de ces œuvres, le jardinier semble avoir un vocabulaire plus riche que celui de Macron. Il faut dire qu’il utilise des termes et une tournure de phrases que peu de gens emploient actuellement. Et je suppose que les professeurs de l’époque parlaient aussi de cette manière. Aujourd'hui, cependant, ce genre de langage soutenu semble avoir disparu. La langue s’est standardisée, et malheureusement, cela ressemble à un nivellement par le bas.
En tant que professeur de langue française, je suis également frappé en regardant la télévision, en écoutant les discours d’hommes politiques. Sont-ils toujours corrects en français ? On entend fréquemment des erreurs, comme le fameux « malgré que ». On ne peut pas dire « malgré que ». Cette expression doit être suivie d’un substantif. Il faut dire « malgré le fait que », mais jamais « malgré qu’il fait froid ». C’est une erreur courante. Certains vont même inventer des liaisons inexistantes, comme prononcer « il va à l’école » avec une liaison entre « va » et « à » (comme « tu vas à »)
L'impact des nouvelles technologies sur l'apprentissage linguistique
Entre ChatGPT et smartphones, le professeur de français partage son expérience des défis contemporains et des solutions mises en place.
Il est vraiment étonnant, voire navrant, d’entendre de telles erreurs, surtout de la part de journalistes ou de personnalités politiques francophones. Il fut un temps où ce genre de fautes aurait été inconcevable dans des discours publics ou à la télévision. Aujourd’hui, malheureusement, cela semble se multiplier. Par exemple, un journaliste sportif dira : « Malgré qu’il a fait un bon match, il a perdu. » Mais « malgré que » n’existe pas ! Il faudrait dire : « Malgré le fait qu’il ait fait un bon match, il a perdu. »
Ces erreurs, qu’il s’agisse de « malgré que » ou de liaisons inexistantes, sont désormais trop fréquentes. Ce n’est pas seulement étonnant, c’est aussi révélateur d’un relâchement dans l’usage de la langue.
Quant au vocabulaire, cela dépend bien sûr du niveau des étudiants. Avec des débutants, je parle très lentement et utilise un vocabulaire simple. Mais à mesure que le niveau des classes monte, le vocabulaire s’élargit naturellement. C’est une progression logique et nécessaire, et cela permet aux étudiants d’atteindre une maîtrise plus fine de la langue.
Ce qui est intéressant, c’est qu’à un niveau avancé, on explore aussi le langage familier. On apprend des expressions issues du verlan, comme zarbi (bizarre), teuf (fête) ou ouf (fou). Ce type de vocabulaire, souvent entendu dans les films ou dans la rue, enrichit la compréhension des apprenants et leur permet de s’adapter à des contextes variés.
Il est aussi courant d’intégrer des mots issus de sa propre langue, comme quelques termes en espagnol par exemple. Cela arrive naturellement et ajoute une dimension interculturelle. En fin de compte, quel que soit le niveau, l’objectif est que les apprenants soient capables de lire, comprendre et utiliser la langue de manière pratique et progressive.
Et la Suisse est un pays unique, avec ses quatre langues nationales. Par exemple, si quelqu’un ne parle pas allemand, est-ce mal perçu par les Suisses ? Est-ce considéré comme une honte, ou bien est-ce acceptable ?
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Autrefois, parler allemand était indispensable, notamment pour progresser dans certains domaines comme les banques suisses, telles qu'UBS ou l'ancienne SBS. Si on ne maîtrisait pas l’allemand, cela pouvait freiner une carrière. Dans l’armée aussi, il était impératif de parler cette langue. Aujourd’hui, cette exigence est moins forte.
Les langues en Suisse : un défi ou une opportunité ?
Témoignage sur l’apprentissage des langues nationales et les anecdotes culturelles dans ce pays multilingue.
Pour ma part, j’ai appris l’allemand pendant sept ans, c’était obligatoire. Quand je vais en Suisse alémanique, c’est toujours un petit choc culturel, mais je fais l’effort de parler allemand avec ce dont je me souviens, car il faut s’adapter. Ce qui est drôle, c’est que souvent, quand je parle allemand là-bas, on me répond en français ! En général, les Suisses alémaniques maîtrisent mieux le français que nous ne maîtrisons l’allemand.
Cependant, il m’est déjà arrivé de croiser un Suisse alémanique qui ne parlait pas un mot de français, et là, mon allemand étant limité, nous avons fini par communiquer en anglais. C’est assez fou quand on y pense : deux personnes vivant à 200 kilomètres l’une de l’autre, ayant le même passeport, doivent se parler en anglais pour se comprendre. Mais au fond, c’est plutôt amusant.
-Si quelqu'un vous demande comment apprendre une nouvelle langue, quels conseils ou règles recommanderiez-vous ?
Je leur dis d'abord que se contenter sur ce qu'ils font à l'école, comme les cours et les devoirs, ne suffira pas. Il faut vraiment chercher à parler français en dehors des heures de classe. Par exemple, regarder la télévision, même si au début on ne comprend presque rien. Au départ, on capte 10%, puis 20%, et ainsi de suite. Mais surtout, il est essentiel d'avoir des amis ou des connaissances francophones. C'est souvent le cas dans des couples : ici, nous avons environ 80% d’étudiantes, et une grande partie d’entre elles est en couple avec un Suisse ou un Français. Dès qu'ils décident de parler français ensemble, les progrès sont considérables. En résumé, il faut pratiquer la langue au quotidien, pas se limiter aux trois heures de cours par jour. C'est déjà un bon début, mais cela ne suffit pas pour bien apprendre.
Un musée du chocolat à l'école : voyage gustatif à travers le monde
Comment une passion pour les chocolats internationaux a transformé une salle de pause en musée unique et convivial.
-Je sais que l'un de vos hobbies consiste à collectionner des chocolats du monde entier. Est-ce que vous continuez toujours cette passion ?
Ah oui on a le musée du chocolat dans la salle de pause, parce que souvent tout ce qui décore l'école ce sont des cadeaux d'étudiants donc je les mets ici, je les expose dans mon bureau dans la salle de pause et puis j'ai lancé cette histoire de chocolat parce que tout d'un coup j'ai eu du chocolat qui venait du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, après aussi de Russie, d'Ukraine, de Slovaquie, de Lituanie, de Hongrie, du Japon, de Suède alors je me suis dit que c'était marrant. J'ai donc découpé les emballages et je les ai mis au mur, c'est le petit musée du chocolat qui est dans la salle de pause.