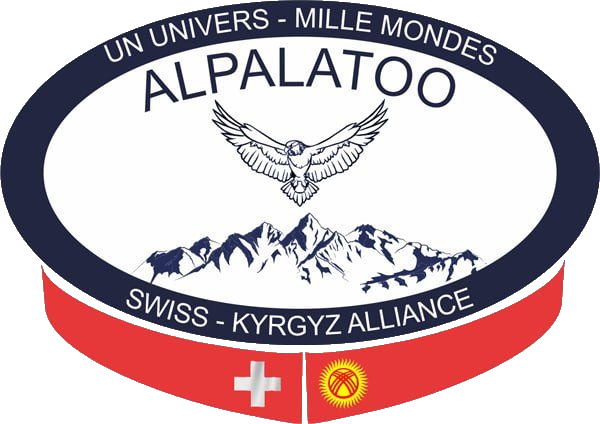Dans cet entretien sincère et plein de mémoire, Jean-Paul, entrepreneur suisse ayant travaillé entre Genève, la Russie et l’Asie centrale, évoque son enfance disciplinée, la simplicité paysanne de ses ancêtres et la transformation du monde des affaires qu’il a vécue. Entre souvenirs familiaux, réflexions sur la Russie post-soviétique et fierté pour la Suisse, il parle avec chaleur de loyauté, d’honneur et de confiance humaine — ces valeurs qui, selon lui, valent bien plus que l’argent. Pour lui, la vraie richesse réside dans la transmission, la dignité et le lien entre les générations, bien plus que dans ce que l’on possède.
– Bonjour et bienvenue à notre projet « Je m’en souviens ».
Un projet consacré à la mémoire de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents — à tout ce qui constitue nos racines.
Est-ce que vous avez eu l’occasion de parler longuement avec vos parents, ou même avec vos grands-parents, pour recueillir plus de mémoire ?
– Mes grands-parents sont morts il y a très longtemps.
Mon père est décédé en 1990 et ma mère en 1998. Nous étions sept enfants dans la famille, donc j’ai pu parler avec mes parents.
Il y avait une grande discipline à la maison : pendant le repas, il était interdit de parler, et pour prendre la parole, il fallait lever la main. Mais les choses se passaient relativement bien. Nous étions bien éduqués, et nos parents étaient fiers de nous.
Mon père était brigadier de gendarmerie, donc gendarme. C’est pour cela qu’il était assez sévère et tenait à la discipline. Il avait d’abord été paysan dans sa jeunesse, puis il avait travaillé dans les usines du canton du Jura. Ensuite, il est venu s’établir à Genève pour devenir gendarme. Son frère était aussi gendarme, ils sont venus ensemble à la gendarmerie genevoise.
Mes grands-parents étaient paysans du Jura, pas loin de Genève. C’étaient des gens de la terre. Mon grand-père est mort quand j’avais huit ans. À l’époque, en général, les gens parlaient peu, s’exprimaient peu sur eux-mêmes. Ils étaient plus dévoués au travail qu’à autre chose. Ils rentraient fatigués le soir.
– Par exemple, votre grand-père ou votre grand-mère ne vous racontaient pas leurs souvenirs ?
– Ma grand-mère, à la maison, aidait beaucoup pour le ménage et pour la cuisine. C’était quelqu’un qui parlait très, très peu. Elle parlait beaucoup avec mon père. En plus, avec mon père, elle parlait le patois, parce que dans le canton du Jura, à l’époque, les anciens parlaient le patois. Ils parlaient souvent en patois pour qu’on ne comprenne pas ce qu’ils disaient. Avec nous, ils parlaient en français, mais entre eux, en patois.
– Patois ? Pourriez-vous parler un peu plus de cette langue ?
– Le patois, c’est une langue régionale. Chaque canton suisse, on peut dire, avait sa langue dérivée du français ou de l’allemand. Cela donnait une langue que seuls les habitants de la région comprenaient. Un peu comme dans le canton des Grisons, c’était vraiment une langue locale, parlée par les anciens.
Par exemple, le Jura appartenait autrefois au canton de Berne, qui était germanophone et protestant, alors que le Jura était francophone et catholique. Quand des Suisses allemands sont venus s’implanter dans le Jura et ont été élus au conseil municipal, les Jurassiens parlaient entre eux en patois pour qu’ils ne comprennent pas !
Aujourd’hui, les gens ne connaissent plus le patois. Il reste quelques personnes qui s’y intéressent par nostalgie, mais c’est fini, les patois.
– Comment était l’époque de vos parents ? Leur enfance ou leur jeunesse était-elle difficile ? Manquaient-ils de beaucoup de choses ?
– Oui, pour les grands-parents c’était très difficile, parce que les paysans étaient pauvres. C’est pour cela que beaucoup, l’hiver, travaillaient dans l’horlogerie ou dans d’autres domaines, car pendant l’hiver, à part s’occuper des bêtes, il n’y avait pas grand-chose à faire.
Autrefois, en Suisse, les paysans fabriquaient souvent les montres dans leur ferme, car ils avaient du temps pendant la saison froide.
Mon père et son frère, comme il n’y avait pas beaucoup de travail dans le canton du Jura, sont venus s’établir à Genève, où il y avait plus d’emplois, c’était déjà plus dynamique. Tous deux sont entrés dans la police.
Nous avions une maison à Corsier, dans la campagne genevoise. Par exemple, nous avions les toilettes dehors, pas de douche, on se lavait au robinet. On se chauffait au bois, puis au charbon, ensuite au mazout que l’on apportait avec des bidons. C’était une vie beaucoup plus difficile.
Nous avions une grande maison, parce que nous étions dix à vivre dedans, et surtout une immense cuisine — parce que nous étions dix à y manger !
– Par exemple, chaque Kirghiz avait le devoir de connaître au moins six générations de ses ancêtres — c’était une obligation.
Aujourd’hui encore, moi par exemple, je connais par cœur jusqu’à la septième génération. C’est très important pour nous, à la fois pour préserver notre identité et pour éviter les problèmes de consanguinité.
Et vous, jusqu’à combien de générations vos ancêtres demeurent-ils présents dans votre mémoire ?
– Je dirais jusqu’aux grands-parents.
Les grands-parents nous parlaient de leurs parents — donc des arrière-grands-parents — mais que nous n’avons pas connus. Nous n’avons pas exprimé beaucoup d’intérêt, parce que nous ne les connaissions pas. Leur vie était rude, simple. C’étaient des paysans. Ce n’étaient pas des gens qui voyageaient, ils n’avaient pas de voiture. Ils prenaient le vélo pour aller à la ville principale. Donc je dirais : les grands-parents.
– À quel point êtes-vous attaché à votre petite patrie, c’est-à-dire au village ou à l’endroit où vous êtes né ?
– Je suis surtout attaché à Genève, à la rive gauche du lac, parce que c’est là où je suis né, où j’ai vécu quand j’étais jeune. Ma femme vient du village voisin, nos parents étaient amis, ils allaient danser ensemble dans les bals. Donc je dirais que je suis très attaché à la rive gauche du canton.
Sur le passeport, je suis originaire d’Ajoie, dans le canton du Jura, et de Corsier, à Genève.
À l’époque, les gens n’aimaient pas beaucoup l’argent ni le pouvoir. Ils étaient surtout des travailleurs. C’était différent : ils n’avaient que le travail. Ils se voyaient parfois entre voisins pour manger, boire un verre, mais tout cela restait dans un rayon de vingt à trente kilomètres autour du village.
– Par exemple, à partir de quel moment la vie en Suisse a-t-elle changé du bon côté ?
Je sais que l’histoire de la Suisse fut auparavant difficile, n’est-ce pas ? Les Suisses travaillaient dur et émigraient ailleurs.
À partir de quelle période ou de quelle année la situation a-t-elle commencé à s’améliorer ?
– Moi, je pense que le grand changement, c’était depuis le début des années 60.
Parce qu’après la guerre, il a fallu un certain temps. On a eu de la chance, car on n’a pas connu la guerre directement, donc pas de destructions. Mais je dirais que c’est vraiment à partir des années 60 que la Suisse s’est développée rapidement : on a vu arriver les voitures, le téléphone, la télévision — toutes les choses qu’on n’avait pas dans les années 50.
– Et avez-vous des rituels spécifiques pour honorer la mémoire de vos parents ? Comment faisiez-vous ?
– Ce qu’on fait, comme catholiques, c’est qu’on célèbre des messes. On en fait lors de la naissance ou de la mort de nos parents. On fait des messes seulement pour nos grands-parents, nos parents, et maintenant aussi pour les frères et sœurs qui sont décédés, car j’ai déjà perdu deux frères.
Donc on se réunit régulièrement pour fêter leurs anniversaires, toute la famille ensemble.
C’est bien, parce que — c’est aussi une question religieuse — chez nous, c’est très important. Quand on fait un rituel pour la mémoire de nos parents, on pense toujours à ces choses-là.
Je me souviens que, quand j’étais petit, la messe faisait partie du quotidien, pas seulement le dimanche. J’allais servir la messe le matin, à 7 heures, et à 8 heures j’étais à l’école. La religion était beaucoup plus proche de l’individu. Les églises étaient bien plus pleines qu’aujourd’hui.
Nos grands-parents, on les appelait « les grenouilles de bénitier », parce qu’ils étaient toujours avec le curé, toujours à l’église. Ils priaient tous les soirs. Il y avait des prières en famille.
Nous aussi, avec mon père, nous faisions des prières en famille. Avant le repas, on remerciait toujours Dieu pour ce qu’il nous accordait.
Quand on est petit, on ne se pose pas de questions. Mais après, on réfléchit : est-ce que c’est bon de remercier Dieu pour la nourriture qu’il nous donne ?
– Et vos grands-parents, par exemple, se sont-ils mariés par amour ?
– Oui, par amour. Ce n’étaient pas leurs parents qui choisissaient. Mais vous savez, comme ils ne sortaient presque jamais du village, sauf pour aller à la ville à 5 ou 6 kilomètres, ils y allaient à vélo.
Comment les gens se connaissaient ? C’est parce que les parents se connaissaient, ils emmenaient leurs enfants, et les enfants finissaient par se connaître. Certains tombaient amoureux, et les parents étaient contents de voir que des familles qui s’entendaient bien mariaient leurs enfants. C’était relativement simple, je dirais.
À l’époque, les gens restaient dans leur lieu d’habitation, dans le village. C’étaient de grands villages, avec leurs amis, leurs enfants. Ce n’étaient pas des mariages arrangés, mais souvent, simplement le fait que les parents se rencontraient et que les enfants aussi.
Ma sœur aînée, par exemple, s’est mariée avec le fils de très bons amis de mon père. Ils se voyaient souvent, elle avait 18–19 ans, et elle est tombée amoureuse du garçon qui venait avec les amis de mon père.
Donc ce n’étaient pas des mariages arrangés, mais des rencontres facilitées par les familles.
– Bien sûr, tout le monde est fier de ses parents, car c’est grâce à eux que nous sommes au monde. Mais au-delà de cela, de quoi êtes-vous fier concernant vos parents ?
– Moi, j’ai toujours été fier de mon père, parce que je trouvais que c’était un homme bien, avec des valeurs essentielles à mon adolescence. Je m’entendais très bien avec lui.
Pour moi, mon père est un exemple, parce qu’élever sept enfants, ce n’est pas facile.
– Et par exemple, votre père vous a-t-il déjà frappé ?
– Oui, à l’époque, c’était normal. Souvent, le soir, quand on allait se coucher, il ne fallait pas faire de bruit. Sinon, il montait, il était fâché. Il ne frappait pas avec les mains, mais il avait toujours une ceinture, toujours quelque chose. C’était normal à l’époque.
C’est vrai que, vu d’aujourd’hui, on se rend compte que c’était une autre époque.
– En Suisse, j’ai remarqué que les maisons de retraite offrent d’excellentes conditions de vie.
Dans mon pays, au contraire, c’est souvent considéré comme une honte de placer ses parents dans une maison de retraite. Ici, ce n’est pas vécu de la même façon, n’est-ce pas ?
– Ça dépend : entre la ville et la campagne, il y a encore des différences.
Dans les campagnes, les parents restent souvent à la maison. Les citadins, eux, mettent plus facilement leurs parents dans les maisons de retraite — qui sont de bonne qualité, mais très chères.
C’est vrai qu’ici, on ne voit pas cela comme une honte, contrairement à certains pays d’Asie centrale ou de Russie, où cela signifie qu’on ne s’occupe pas de ses parents.
Par exemple, ma grand-mère est morte à la maison. Ma belle-mère a 90 ans, elle vit encore en appartement. Elle a déjà vécu en maison, mais elle préfère rester chez elle. Certains sont contents d’aller en maison de retraite, d’autres non. Mais ce n’est pas une honte.
C’est entré dans les mœurs, je dirais. Il y a cinquante ans, c’était une autre mentalité. Par exemple, quand ma grand-mère est morte, jamais on n’aurait eu l’idée de la mettre en maison. C’était logique qu’elle finisse ses jours avec nous.
Après, selon le degré de maladie de la personne, c’est une autre approche. Mais aujourd’hui, c’est devenu quelque chose de normal.
– Est-ce que vous avez des regrets par rapport à vos parents ou vos proches ?
– Non, parce que, quand on a commencé à travailler, mes frères, mes sœurs et moi, on a beaucoup fait pour nos parents.
J’ai beaucoup voyagé avec mon père, mon frère aîné aussi l’a souvent emmené en voyage.
On a beaucoup donné à nos parents ce qu’on avait reçu d’eux.
Quand mon père est décédé, je crois qu’il était content de ses fils et de ses filles, parce qu’on s’est beaucoup occupé d’eux.
On partait souvent le week-end, on faisait plein de choses ensemble.
Et puis, ils étaient à la retraite, donc ils avaient le temps d’en profiter.
Nous, les sept enfants, avons eu seize petits-enfants au total.
Le plus grand problème, surtout pour mon père, c’était de se souvenir du nom de tous ces petits-enfants !
Je n’ai pas de regrets, parce qu’on a fait beaucoup de choses ensemble.
Le premier voyage en Russie, en Union soviétique, c’est moi qui l’avais offert à mon père.
C’est pour ça que je n’ai pas de regrets. Et puis, je vais de temps en temps le voir au cimetière, je lui parle, et je crois qu’il est fier de ses enfants.
Chez nous, chez les Kirghiz, il existe un proverbe qui dit : il y a un fils qui est l’égal de son père, un fils qui lui est inférieur et un fils qui le dépasse. Autrement dit, un fils peut être meilleur que son père. Si je vous posais cette question, comment répondriez-vous ? Quel genre de fils pensez-vous être ?
— Chez nous, le respect de l’aîné est fondamental. Mon frère aîné, nous l’avons toujours considéré comme le patriarche. Quand notre père est décédé, c’est lui qui a pris le relais, qui est devenu le centre de la famille : il organisait tout, conseillait tout le monde, décidait des grandes choses. Nous n’étions pas toujours d’accord avec lui, mais c’était la tradition : c’est l’aîné qui tient la maison. Il a gardé ce rôle jusqu’à sa mort, il y a trois ans. Nous l’appelions toujours le patriarche.
Mais au fond, pour moi, la vraie valeur n’est pas dans la position ou le rôle, elle est dans la personne elle-même. Nous avons eu la chance de vivre une période favorable. Depuis les années 1970, l’économie suisse était en plein essor : on trouvait du travail facilement, on pouvait quitter un emploi un jour et en retrouver un autre le lendemain. Mais malgré cette prospérité, l’exemple qui reste pour nous, c’est notre père. Il demeure pour ses enfants la figure de référence, l’homme exemplaire.
— À quel âge de votre vie avez-vous trouvé votre véritable chemin ?
— Vous savez, un Suisse qui ne parle pas l’allemand, ça ne marche pas ! C’est pour cela que je suis parti à Zurich. Ma sœur y travaillait déjà, et je crois que c’est ce séjour qui m’a orienté vers ce que j’aimais vraiment. J’ai commencé à travailler à la bourse de Zurich pour m’occuper de la clientèle francophone. J’avais 23 ans, et j’ai tout de suite compris que j’étais à ma place. C’était passionnant : j’apprenais chaque jour quelque chose de nouveau. Ce poste a été le véritable détonateur de ma carrière.
Le deuxième grand tournant, c’était en 1984, lors d’un voyage à Moscou et à Saint-Pétersbourg. J’y suis allé une semaine pour Noël et le Nouvel An : visiter, aller au Bolchoï, au Kirov (aujourd’hui le Mariinsky). Ce fut un voyage culturel inoubliable, fascinant. Il m’a ouvert à la culture russe, à sa littérature, à sa musique, et plus tard à tout le monde russophone – de l’Asie centrale au Caucase. Ces gens n’avaient pas d’argent, mais ils possédaient une richesse incroyable : leur culture.
— En parlant du chemin de la vie, comment savoir que celui que nous suivons est vraiment le nôtre ? Y a-t-il, selon vous, des signes ? Que conseilleriez-vous aux jeunes qui se demandent souvent : “Est-ce vraiment mon chemin ?”
— Je crois qu’il faut suivre ses envies. Moi, j’aimais la culture russophone. Puis, il y a eu la chute du mur de Berlin, la perestroïka… Dans les années 1990, je savais que les privatisations en Russie allaient offrir d’immenses opportunités. J’y ai participé, c’était une période très sauvage : il fallait des gardes du corps, tout était dangereux, mais passionnant. Il y avait deux mondes : ceux qui gagnaient énormément et ceux qui souffraient de la fin de l’Union soviétique. J’ai vécu des années intenses, uniques.
Et puis, mes études aux États-Unis ont aussi été un grand moment : New York, San Diego… J’ai choisi New York parce que les marchés financiers étaient là-bas. Il faut suivre ses idées, ne jamais hésiter à faire ce qu’on ressent. Sinon, on vit frustré toute sa vie.
— Vous avez pris de nombreux risques au cours de votre vie pour progresser dans le monde des affaires. Pensez-vous que le risque est une force, une nécessité ?
— Oui, bien sûr. Quand j’étais en Russie, ma famille vivait à Genève. Je faisais quinze jours là-bas, quinze jours ici : c’était compliqué. Et puis, les années qui ont suivi la perestroïka étaient dangereuses. Les privatisations étaient totalement anarchiques. De 1993 à 2003, c’était une époque très dure, mais aussi fascinante. Ensuite, les choses se sont un peu stabilisées : la police est devenue moins corrompue, les affaires plus structurées. Mais ces dix premières années étaient d’une intensité incroyable.
L’URSS était en faillite. Pour renflouer l’État, il fallait vendre ce qui appartenait au gouvernement. C’est ainsi que sont apparus les oligarques. La plupart venaient de milieux juifs, et ils ont pu acheter des pans entiers de l’économie grâce aux capitaux venus d’Occident. Évidemment, pour le peuple, ce fut une tragédie : il n’a rien gagné, souvent il a tout perdu.
— Avant de partir en Russie, vous étiez déjà engagé dans le monde des affaires, n’est-ce pas ?
— Oui, bien sûr. J’avais étudié aux États-Unis dans les années 1980, puis occupé des postes de direction dans des banques genevoises. J’aurais pu y rester, avec une carrière stable et confortable. Mais moi, j’ai toujours été attiré par ce qui se passait ailleurs, par le mouvement, par le monde. C’est ce goût de l’aventure économique et humaine qui m’a poussé à me lancer à mon compte.
— À quel âge avez-vous commencé à voler de vos propres ailes, en devenant un entrepreneur indépendant et couronné de succès ?
— J’avais 38 ans. J’avais déjà eu beaucoup de succès dans les banques, où j’étais responsable du département de bourse et où je gagnais bien ma vie. Mais à 38 ans, j’ai décidé de créer ma propre voie. C’est à ce moment-là que je suis devenu vraiment indépendant.
— Vous avez collaboré avec des personnes de nombreuses nationalités et travaillé dans différents pays. D’après votre expérience, certaines cultures ou nationalités vous semblent-elles plus entreprenantes ou plus habiles dans le monde des affaires — plus “débrouillardes”, comme on dit ? Peut-on, selon vous, établir une telle distinction ?
— Si vous voulez, à l’époque soviétique, la plupart des gens travaillaient pour l’État. Ils n’avaient donc aucune motivation personnelle. Puis, du jour au lendemain, avec les privatisations, certains d’entre eux sont devenus riches. C’est là qu’on peut vraiment parler de débrouillardise : celui qui gérait un restaurant ou l’entretien d’un immeuble, par exemple, a su s’arranger avec les notaires locaux pour devenir propriétaire du lieu, ou pour racheter une entreprise. C’était une forme d’instinct de survie et d’intelligence pratique.
Ce que j’ai trouvé fascinant dans les pays russophones, c’est l’honnêteté fondamentale des gens. Très souvent, on n’avait même pas besoin de signer de contrat : on se serrait la main, et cela suffisait. Quand quelqu’un vous invitait chez lui, vous présentait sa femme et ses enfants, vous saviez que la confiance était là. Et cette confiance, elle se mérite, elle se construit lentement. Ce n’est pas comme aux États-Unis, où tout semble facile, rapide : « How are you doing, Jean-Paul, nice to see you ! », et le lendemain on vous a oublié.
En Russie, les véritables amis que je me suis faits, je les ai toujours. Ce sont des relations solides, sincères. Là-bas, quand un client vous fait confiance, c’est comme un patient avec son médecin : il vous raconte tout, sa vie, ses secrets, ses problèmes… Et cette relation de confiance, pour moi, c’est quelque chose d’extraordinaire. C’est tout l’esprit de l’ancienne Union soviétique, et c’est profondément humain.

— Après la chute de l’URSS, la corruption était omniprésente, des petits bureaux administratifs jusqu’au Kremlin. Comment parveniez-vous à agir dans un tel contexte ? Avez-vous dû, d’une certaine manière, vous adapter à cette mentalité pour avancer ?
— Non, jamais. Je n’ai jamais accepté la corruption. Bien sûr, je la connaissais, je la voyais partout. Mais dès le départ, j’ai voulu montrer qui j’étais et d’où je venais. Sur la porte de mon bureau, j’avais les drapeaux suisse et russe, et ma société s’appelait ASR Suisse–Russie.
Beaucoup de Russes, de Caucasiens aussi, venaient me faire des propositions bizarres, parfois même des mafias sont venues me voir. Mais je travaillais partiellement pour le gouvernement suisse, et cela me protégeait. Et puis j’avais une secrétaire exceptionnelle, une ancienne du KGB, qui connaissait tout ce milieu et savait très bien gérer les situations délicates.
Franchement, je n’ai jamais eu de gros problèmes, à part quelques vols dans le métro. Dans les pays de l’ex-Union soviétique, on peut faire confiance aux gens, à condition de ne jamais se laisser entraîner dans des affaires douteuses. On m’a souvent proposé des “bakchichs”, des pots-de-vin — j’ai toujours refusé.
— Et les Russes ? Il m’arrive parfois de demander, avec un sourire, à ceux qui travaillent là-bas : avez-vous fini par apprendre à boire la vodka comme eux ?
— (Rires.) Oui, c’est vrai que pendant mes dix premières années en Russie, j’ai beaucoup bu. C’était inévitable ! Mais ensuite, j’ai complètement arrêté, parce que ce n’était plus possible de tenir ce rythme.
Les Russes de ma génération buvaient énormément. Mais les jeunes, aujourd’hui, ne boivent presque plus. Mon associé, par exemple, ne boit pas du tout. La consommation d’alcool a beaucoup diminué. Quand je vais en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, on m’invite à dîner, on me propose toujours un petit verre de vodka “pour la famille”, mais cela reste symbolique. On n’est plus dans la culture de l’ivresse. Cela reste une tradition, une marque de respect, mais les choses changent.
Et puis, vous savez, ma plus grande erreur au début a été de penser que, parce que les gens me ressemblaient physiquement — blancs comme moi — ils pensaient comme moi. J’avais complètement tort. Leur mentalité est différente, leur rapport au temps, à la parole, à la vie, tout est différent. Il m’a fallu des années pour comprendre cela.
Et quand j’ai enfin compris que je m’étais trompé, que je devais m’adapter à leur manière de penser, cela a tout changé. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réussir véritablement. Parce qu’en réalité, la mentalité russe est un mélange unique d’Europe et d’Asie. Et cette complexité, une fois qu’on l’a comprise, devient une grande richesse.
— En Suisse, l’industrie pharmaceutique semble occuper une place majeure dans l’économie, suivie de près par l’horlogerie. Selon vous, quel secteur est aujourd’hui le plus influent sur le plan financier ?
— Oui, la pharma est clairement numéro un. Elle représente une part essentielle du produit intérieur brut. En ce moment, d’ailleurs, il y a des discussions importantes avec les États-Unis à propos des droits de douane, et les géants pharmaceutiques suisses ont un véritable pouvoir de négociation.
Novartis, par exemple, a annoncé un investissement d’une cinquantaine de milliards de dollars aux États-Unis, et Roche prévoit à peu près la même chose, notamment pour construire de grandes usines de production. Cela leur donne un poids énorme dans les discussions internationales.
Mais la Suisse a aussi la chance d’avoir un tissu économique extrêmement diversifié : beaucoup de petites et moyennes entreprises, une industrie forte, et bien sûr l’horlogerie. Ce n’est pas toujours facile : il suffit d’une mini-crise pour fragiliser des cantons comme le Jura, qui dépendent beaucoup de la sous-traitance horlogère — aujourd’hui, près de 10 % des travailleurs y sont au chômage partiel.
Mais globalement, oui, la Suisse doit beaucoup à la pharma. C’est notre moteur économique.
– En Suisse, l’État soutient efficacement les entrepreneurs, n’est-ce pas ?
– Oui, bien sûr. L’État, les chambres de commerce… tout est bien organisé en Suisse. C’est d’ailleurs un pays qui sert souvent d’exemple à ses voisins.
– J’ai lu ce matin qu’en 2024, la Suisse comptait 41 milliardaires. Chaque année, le magazine Bilan publie aussi la liste des 300 plus grandes fortunes du pays. Que vous inspirent de tels chiffres ? Quelle réflexion cela suscite-t-il chez vous ?
– Eh bien, si l’on compare avec les États-Unis ou l’Asie, 41 milliardaires, ce n’est pas tant que ça. La Suisse reste un petit pays. Bien sûr, il y a des fortunes héritées, notamment dans le domaine pharmaceutique. Il y a aussi des entrepreneurs comme M. Blocher, ancien politicien et industriel prospère. Certains milliardaires se sont établis ici pour des raisons fiscales, avec des forfaits intéressants. Personnellement, cela ne m’impressionne pas. Tant mieux s’ils sont là : plus il y en a, mieux l’économie se porte, car ce sont des gens qui dépensent beaucoup en Suisse.
Je crois qu’il y a surtout beaucoup de millionnaires. En Suisse, si vous possédez une maison et un fonds de pension, vous atteignez vite le million. C’est donc assez courant. Et c’est positif pour l’économie intérieure : ces gens dépensent localement, dans un pays où la TVA reste raisonnable, ce qui encourage la consommation sur place plutôt qu’à l’étranger.
– Mais tout de même, êtes-vous fier de vivre dans un pays qui affiche de tels chiffres à l’échelle mondiale ?
– Oui, extrêmement fier. Nous avons des écoles, des universités, des hautes écoles spécialisées qui figurent parmi les meilleures au monde. Elles possèdent des centres de recherche à la pointe, qui produisent des innovations remarquables. Dans les domaines des nouvelles technologies, de l’intelligence artificielle, de la blockchain ou des cryptomonnaies, la Suisse est vraiment au top.
Je suis fier et heureux que mes enfants soient nés et travaillent ici. En Suisse, nous n’avons pas de grands problèmes majeurs. Le système de santé est excellent. Franchement, ceux qui se plaignent devraient aller voir ailleurs. C’est un pays bien structuré, efficace, sans corruption, avec de très bonnes conditions pour les affaires. Nous pouvons vraiment être fiers d’être Suisses.
– D’après votre expérience, quels sont, selon vous, les principaux atouts et les faiblesses de la Russie, sur le plan économique, culturel ou politique ?
– Le principal problème de la Russie, c’est son retard sur l’Occident. Les infrastructures – routes, chemins de fer, hôpitaux – sont encore très en deçà. Et quand la richesse reste concentrée dans les mêmes mains, cela freine le développement. Pourtant, la Russie a un potentiel immense : des ressources naturelles extraordinaires – gaz, pétrole, or, uranium. Elle pourrait vivre uniquement de cela. Le Kazakhstan aussi, d’ailleurs.
La Suisse, elle, n’a pas de matières premières, mais elle a le brain, le cerveau. C’est ce qui fait sa force. En Russie, beaucoup plus de choses pourraient être accomplies. Je suis toujours heureux quand je vois des projets d’infrastructure, comme récemment l’annonce d’une modernisation du réseau ferroviaire, ou la reprise des trains directs entre Astana et Moscou après huit ans d’interruption. Ce sont de bonnes nouvelles.
La Russie est un pays riche, qui pourrait faire davantage pour son peuple. Mais on a vu avec les sanctions qu’elle a su s’adapter, développer des secteurs locaux et se montrer flexible. Les pays russophones ont donc encore beaucoup de potentiel.
– Selon vous, qu’est-ce qui distingue les hommes d’affaires venus d’Occident de ceux originaires de l’Orient ? Y a-t-il, dans leur manière de penser ou d’agir, des différences marquantes ?
– Oui, la grande différence, c’est que, dans les pays occidentaux, les fortunes se sont construites sur plusieurs générations. Dans les pays de l’ex-URSS, cela ne fait qu’une trentaine d’années que les gens peuvent vraiment faire fortune. Les privatisations ont créé des fortunes immenses, mais aussi permis à une classe moyenne de se développer, ce qui est positif.
– Il y a un vieux proverbe que j’aime beaucoup. Un homme disait à son fils : “Quand je mourrai, enterre-moi avec mes chaussettes.” Mais lors de l’enterrement, le religieux refusa : “Non, c’est interdit, personne ne part avec quoi que ce soit.” C’est une manière de dire que nous naissons nus, et que nous repartons nus.
Vous qui avez beaucoup voyagé, travaillé dans la finance, côtoyé la richesse sous toutes ses formes — qu’est-ce que la richesse pour vous, au fond ? Est-ce qu’aimer l’argent, c’est une bonne ou une mauvaise chose ?
– J’entends bien. Mon métier est lié à l’argent, nos sociétés existent pour en générer. Mais pour moi, l’argent n’est pas une fin en soi. Ce qui compte, c’est que ma famille soit à l’abri le jour où je ne serai plus là. L’idée, c’est de leur laisser un patrimoine qui leur permette de vivre confortablement.
Si j’étais obsédé par l’argent, je serais peut-être malhonnête, j’accepterais des propositions douteuses. Mais je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Vous avez raison, votre proverbe est très juste : on ne part avec rien, pas même ses chaussettes.
Dans la tradition catholique, on peut être enterré habillé comme on le souhaite, parfois avec des objets ou des photos dans le cercueil. D’ailleurs, beaucoup de personnes âgées prévoient une lettre indiquant ce qu’elles souhaitent avoir avec elles. Moi, j’ai déjà fait ma liste.