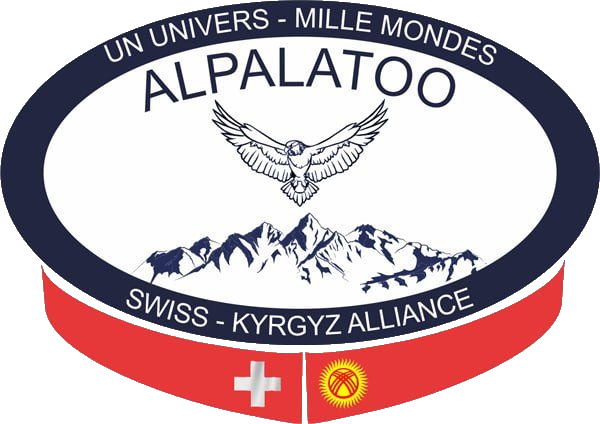– Vous venez de rentrer aux États-Unis. Quelle est, selon vous, l’ambiance politique générale dans le pays ?
– En effet, je reviens d’un voyage en Californie, avec un passage par Washington au retour. Je peux dire que l’ambiance est particulièrement lourde en ce moment aux États-Unis, empreinte de préoccupations et, osons le dire, de peur. C’est un sujet omniprésent dans les conversations, que ce soit avec la personne assise à côté dans l’avion, entre amis ou lors de rencontres fortuites : on ne parle quasiment que de cela.
– Le pays est-il plus divisé qu’auparavant ? Comment la population réagit-elle aux nouvelles propositions de Donald Trump ? À votre avis, y est-elle majoritairement favorable ou plutôt opposée ?
– Très clairement, la majorité du peuple s’oppose aux principales initiatives proposées ou entreprises par le président Trump. Ce n’était pas nécessairement le cas il y a cent jours, mais, jour après jour, son taux de popularité diminue. Cette semaine, il a atteint seulement 45 % d’opinions favorables, ce qui signifie que l’opinion publique est désormais majoritairement défavorable à son action.
– Surtout dans quels États, par exemple ?
– Ce qui est intéressant, c’est que ce phénomène est généralisé. Ce n’est pas seulement une baisse dans les États « bleus », démocrates, qui étaient de toute façon déjà majoritairement opposés à Trump, mais aussi dans les États « rouges », républicains. Ses propres électeurs commencent à se rendre compte que les promesses qui leur avaient été faites ne sont pas tenues — et qu’il se produit même souvent l’inverse. Trump avait affirmé qu’en un seul jour, il ferait en sorte que la paix règne entre la Russie et l’Ukraine, que les prix des œufs chuteraient au plus bas, et que, d’une manière générale, l’inflation serait maîtrisée.
Il a promis la terre, le ciel et les étoiles — et beaucoup y ont cru. Ils se sont dit : « Voilà un programme réjouissant », et ils ont voté pour lui.
Mais aujourd'hui, une large part de cet électorat réalise qu’elle a été trompée — et elle est loin d’être satisfaite. À tel point que les députés et sénateurs républicains, lorsqu’ils retournent dans leurs circonscriptions pour rencontrer leurs électeurs, se font accueillir par des jets de tomates. On leur demande pourquoi ils restent silencieux, pourquoi ils ne s’opposent pas aux actions du gouvernement actuel.
La situation est devenue si tendue que le parti républicain conseille désormais à ses élus d’éviter les visites publiques et, s’il le faut, de « se cacher sous leur bureau » à Washington. Nous en sommes là.
– Mais pensez-vous que certaines de ces propositions sont tout de même justifiées ou raisonnables ? Par exemple, quelles mesures ou idées pourriez-vous soutenir ?
– Là, vous me posez une question extrêmement difficile. Je peux vous raconter une petite anecdote : je participe assez régulièrement à des émissions sur la chaîne LCI à Paris, notamment avec mon ami Darius Rochebin. Un jour, il m’a demandé si je pourrais trouver un supporter de Trump — un « trumpiste raisonnable » — pour dialoguer avec moi lors d’une prochaine émission.
Je lui ai répondu que, selon moi, l’expression « trumpiste raisonnable » relevait de l’oxymore : cela se contredit en soi. Mais j'ai promis de faire de mon mieux. J’ai donc approché deux ou trois personnalités politiques républicaines favorables à Trump pour leur proposer de participer.
Malheureusement, tous sont commentateurs sur Fox News et, contractuellement, ils n’ont pas le droit d'apparaître sur une autre chaîne. Je suis donc toujours à la recherche de mon « trumpiste raisonnable » — mais peut-être finirai-je par en trouver un !
Quant à soutenir une action de Trump au cours de ses cent premiers jours de gouvernance, honnêtement, je n’en vois aucune. Il n’y en a pas une seule que je pourrais approuver.
Je me suis d’ailleurs souvent demandé pourquoi les anciens présidents américains avaient mis autant de temps avant de réagir. Il est vrai qu’aux États-Unis, la tradition veut que les anciens présidents évitent de critiquer publiquement leur successeur, par courtoisie institutionnelle.
Mais beaucoup, comme moi, estiment que les outrances de Trump — son incohérence, son incompétence, sa cruauté — étaient d’une telle ampleur qu'il était impératif que Barack Obama et George W. Bush prennent la parole.
Ils l'ont fait, certes sans jamais prononcer explicitement le nom de Trump, mais en insistant sur l'importance de défendre le droit constitutionnel, la liberté d’expression et le respect des alliances internationales historiques. Tout le monde a compris de qui ils parlaient.
Et je m'attends à ce que leurs voix continuent de se faire entendre.
– Mais comment expliquer malgré tout la popularité du président Trump, en dépit des nombreuses controverses politiques ?
– Pourquoi 45 % des Américains continuent-ils à le soutenir ? Voici ma réponse : le système éducatif américain ne dépend pas du gouvernement fédéral, ni même uniquement des États fédérés ; il dépend principalement des municipalités.
Or, plus une municipalité dispose de faibles ressources, plus la qualité de l'enseignement y est médiocre — notamment dans les zones rurales et agricoles, qui sont en général politiquement républicaines.
Dans ces régions-là, tragiquement, le niveau éducatif est souvent comparable à celui de pays du tiers-monde. Cela produit, génération après génération, des citoyens relativement peu instruits, marqués par des préjugés racistes, misogynes ou homophobes.
Ces populations, se sentant validées dans leurs sentiments par l’accession d’« un des leurs » à la présidence, deviennent des proies faciles pour la désinformation et la manipulation.
Voilà pourquoi, encore aujourd’hui, environ 45 % de la population continue de soutenir Donald Trump. Mais je m’attends à ce que ce taux de popularité continue de s’éroder, et d’ici au prochain cycle électoral, en novembre 2026, il pourrait se passer beaucoup de choses.
– Y a-t-il une évolution dans la perception du rêve américain ? Est-il encore vivant ?
Pour ma part, ma réponse est claire : à l'heure actuelle, non, le rêve américain n'est plus vivant.
La véritable interrogation est de savoir s'il peut être ressuscité, s'il est encore possible d’interrompre cette déviation dramatique.
Aujourd’hui, nous ne vivons plus le rêve américain, mais bien le cauchemar américain.
Combien de temps cela durera ? Nous le verrons. Qui vivra verra.
– L'Amérique actuelle est-elle un modèle pour le monde ?
– Absolument pas. Pas plus que la Russie de Poutine ou la Corée du Nord. Non, au contraire. Aujourd'hui, l’Amérique est l'illustration parfaite de ce qu’il ne faut pas devenir.
Et malheureusement, cette perception ne cesse de se renforcer à travers le monde.
Le tourisme aux États-Unis, qui constitue une source importante de revenus, a déjà chuté de près de 25 % en seulement cent jours.
Très bientôt, les restaurateurs, les hôteliers, les agences de voyages, les compagnies aériennes vont commencer à pousser des cris d’alarme, car leur survie économique sera menacée.
Et lorsqu'on touche au portefeuille des gens, les opinions ont tendance à changer. Nous y arrivons.
De même, lorsque les agriculteurs de Californie ou du Montana se rendront compte qu’il n’y a plus personne pour cueillir les avocats ou vendanger, ils s’interrogeront : « Mais où sont passés ces travailleurs ? »
La réponse est tragique : ils ont été expulsés ou se sont vu refuser l'entrée sur le territoire.
C’est là une des initiatives de Trump dont les conséquences seront désastreuses. Elles le sont déjà, d’ailleurs.
– Existe-t-il une opposition forte et structurée à cette administration aujourd’hui ?
– Il n’y a pas d’opposition forte ni structurée. Le Parti démocrate a été tellement paralysé par cette élection qu’il a mis énormément de temps à élaborer une stratégie d’opposition ou de résistance cohérente. Certains suggèrent même que le Parti démocrate devrait envisager de se rebaptiser, à l’image du Parti socialiste français qui a disparu du paysage et a dû adopter un nouveau label. À mon avis, les démocrates devront également réfléchir sérieusement à cela avant la prochaine échéance électorale, à moins que nous n'ayons déjà atteint un point de non-retour, avec une explosion ou une insurrection populaire.
Une autre possibilité serait que les représentants républicains au Sénat et au Congrès trouvent finalement le courage de se dresser contre Trump, réalisant que leur propre position est en danger, menaçant leur réélection face à des électeurs qui leur lancent des tomates en signe de protestation. Cela pourrait les inciter à se lever, à s’opposer et à dire « C’est fini, Trump ». Il se pourrait même que l’on assiste à une procédure d’impeachment, cette fois votée non seulement par les démocrates, mais aussi par une fraction des républicains. Bien sûr, cela ne représente qu’une chance sur dix, mais ce n’est pas complètement inconcevable.
Et puis il y a l’option d'une sécession des États-Unis : que les États du Pacifique, comme Washington, l’Oregon, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et Hawaï, décident de se séparer. Et que cette même dynamique touche les États de la côte Est, du Maine à la Caroline du Nord, avec la même décision. Ce scénario de sécession, bien qu’extrême, n’est pas totalement irréaliste. Cela laisserait les « pauvres bougres » dans le Minnesota, le Wisconsin et le Michigan avec peu d'autres choix que de rejoindre le Canada, tandis que d'autres se trouveraient dans un immense vide politique. C'est une hypothèse qui, aujourd'hui, semble moins farfelue qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois.
– Mais dans ce climat, comment peut-on encore espérer voir un jour un retour à une forme de gouvernance démocratique stable ?
– C’est là toute la question. Le journalisme tel que nous l’avons connu depuis l’époque de Gutenberg est pratiquement mort. Aujourd’hui, tout le monde peut être journaliste : il suffit de publier sur YouTube ou de taper un message sur son iPhone pour se déclarer comme tel. Et même des journaux aussi prestigieux que le New York Times ou le Financial Times sont menacés de disparition. La question fondamentale qui se pose est : comment va-t-on instruire les gens dans ce contexte ? Comment éviter que la désinformation ne devienne la norme à travers les réseaux sociaux ? Cette situation m’effraie énormément. Et elle me fait encore plus peur pour les générations à venir.
En seulement 100 jours de gestion désastreuse, l'actuel régime a déjà détruit la crédibilité et le respect accordés à la démocratie américaine. Cela affecte aussi, de manière plus large, l’idée même de démocratie dans le monde. Pourtant, l’expérience démocratique reste très récente à l’échelle de l’histoire humaine. En prenant comme point de départ la Grande Charte de 1206 et en arrivant à l’an 2025, on voit bien que cette forme de gouvernance ne constitue qu’une fraction minuscule du parcours humain, une portion de quelques siècles seulement. Il est donc possible que ce chapitre de l’expérimentation démocratique se referme, pour laisser place à une société où la loi du plus fort prévaut. C’est terrifiant. Et c’est là que se trouve la question existentielle : allons-nous assister à un tel basculement ?
C’est pourquoi il est impératif de résister, de s’opposer, de dire « stop », même si cela comporte des risques. Mais c’est également une réalité qu’il est difficile à accepter : les États-Unis sont en train de se doter de ce qui pourrait être l’équivalent moderne du goulag, à l’image des prisons de Guantanamo Bay ou des établissements au Salvador. Ces idées qui font frémir sont pourtant en train de devenir des faits concrets. Ce qui était impensable il y a 100 jours est désormais une possibilité. J’imagine très bien qu’un jour je me retrouve à la frontière américaine, avec un garde qui, en scrutant mon passeport, me dise : « Ah, vous êtes sur la liste, direction Guantanamo Bay ». Ce n’est pas encore arrivé, mais, une fois de plus, cela n’est pas totalement inconcevable. Nous avons vu ces derniers jours des individus arrêtés dans la rue, embarqués dans des avions et envoyés au Salvador, sans avoir commis le moindre délit, sans jugement. Ce n’est pas cela l’Amérique, ce n’est pas la démocratie.